DÉLIRE GOURMAND
Par Michel Bellin le lundi 21 juin 2010, 08:22 - Lien permanent
Attention ! aujourd'hui, ce n'est pas un « bref billet » comme l'annonce indûment mon blog, mais presque une Encyclopédie voire une Bible, tant par la densité et la longueur du morceau choisi (honni soit qui mâle y pense) que par son inspiration et sa ferveur ! Je n'y peux rien et je m'en excuse : ma Muse est parfois indocile et trop féconde et je n'ai pas encore appris à lui rogner les ailes tant son chant m'enivre devant mon clavier qui fume !
Donc, de la patience, beaucoup d'attention et de patience pour décrypter le délire qui va suivre. Et que les envieux et les jaloux et les détracteurs de bellinades et tous les homophobes mal baisés passent leur chemin.
Quant aux autres, qu'ils (elles) ajustent leur ceinture de sécurité après avoir dénoué celle de chasteté !
Donc, de la patience, beaucoup d'attention et de patience pour décrypter le délire qui va suivre. Et que les envieux et les jaloux et les détracteurs de bellinades et tous les homophobes mal baisés passent leur chemin.
Quant aux autres, qu'ils (elles) ajustent leur ceinture de sécurité après avoir dénoué celle de chasteté !

In principio erat Verbum. Commençons par le commencement. Avec des mots pour le décrire. Dimanche dernier (hier), long réveil paresseux. Pensée flottante, corps reposé, migraine envolée, sourire aux lèvres… Simple bonheur, pardon, simple bien-être d'être en vie : une (belle) journée de plus… en moins. Et tant pis pour le ciel gris et cette fraîcheur de Toussaint à la veille de l'été !
Désespérant toutefois de rendre physiquement présent l'être aimé, ne serait-ce que pour lui partager au lit ce moment de pure félicité, ce temps délicieusement dilaté et alangui – mais ma trouvaille relève plus de l'ingénuité que de la mélancolie, encore moins de quelque compensation sensuelle – bref, j'ai soudain imaginé ce subterfuge corporel : mes mains, en se croisant sur la poitrine, ont fortement et longuement étreint mes propres épaules, comme les lèvres d'une même bouche qui se baiserait elle-même. Délire de Narcisse ? Nenni. Juste la force inventive de mon imaginaire innervant délicieusement la proximité de deux peaux, muscles, membres, replis… et jusqu'au sourire impalpable et à la joue abrasive qu'un doigt virtuel tendrement câline. Question : l'isolement tactile s'achève-t-il là où commencer l'amor amicitiae ? Ou inversement ? Restent à présent les mots (qui peut partager avec moi cette évidence de la sensualité des mots qu'on n'a de cesse de malaxer et de caresser ?!). Ces mots toujours un peu fous et trop pauvres, pas suffisamment expressifs et parfois bêtement lyriques, ces mots incessants et redondants pour exprimer ce qui frustre et enchante ma vie !
D'où cette envie d'entonner ce matin un hymne vibrant. Comme lorsque, dressé dans le chœur, sous ma coule immaculée, les yeux tournés vers le vitrail inondant mon cœur, je chantais mon allégresse sacerdotale : « Soleil levant sur ceux qui gisent dans la nuit, tu es venu pour que voient ceux qui ne voient pas… » J'étais jeune et fervent alors. Mais je ne connaissais rien au corps, à la matière, à l'amour incarné. Sauf un divin Amant évanescent et les ravissements de l'âme, cette gélatine pieuse, ces bouillonnements ineffables qui clapotent à l'intérieur sans jamais atteindre les rives du réel. Tu l'auras compris, ami internaute, il s'agira ici d'une toute autre chanson que désapprouvent fort le Vatican et tous les tenants de l'ascèse chrétienne !
Car ils me font bien rire tous ces psys mal baisés et moralisateurs hétéronormés qui encensent l'incontournable “ altérité ”, condition sine qua non d'une rencontre humaine véritable et durable. Quelle blague ! Quel stupide matérialisme, quel simplisme biologique ! Comme si deux bites mutuellement éprises et conquises ne pouvaient s'enraciner que dans “le même” pour n'engendrer ensuite que mimétisme psychologique, uniformité mentale et platitude spirituelle ! Entre nous deux, tout nous unit parce que (presque) tout nous sépare mais l'amitié virile est notre commun dénominateur. Il s'agit de paire, plus que de couple. Il s'agit de bien-être, pas de bonheur. De connivence dans la dissemblance. Simplement le bien-être lorsqu'il est à la fois profond et léger, mental et corporel, occasionnel et perpétuel, en tout cas jamais fusionnel. Car tout passe par le corps, plage de l'esprit et l'Ami a bien raison lorsqu'il conclut qu'il s'agit en définitive moins d'homosexualité que d'homophilie. Je préfère parler d'amitié amoureuse. Cicéron disait : amor amicitiae.
Il m'a confié que sa légitime moitié (selon la plaisante expression consacrée) s'est mis en tête qu'enfin il s'explique et s'explicite et s'ausculte l'âme sans faux-fuyant ! Il y a quelque temps, de vive voix, elle lui avait demandé : « C'est vraiment plus facile la communication entre deux hommes, plutôt qu'entre un homme et une femme ? » Il a répondu par l'affirmative. Ce qui n'explique pas grand chose et ne prouve à peu près rien. D'où sa relance par courriel. (Ah ! si la dame connaissait l'existence de ce blog, elle comprendrait tout sur-le-champ à défaut d'être édifiée !) Comme elles nous guettent, nous harcèlent et brûlent de comprendre ! Mais nous ne voulons pas mettre les femmes sur la touche ni à leur contact faire la fine bouche. Ni leur dérober quoi que ce soit. Disons que c'est autrement, ni mieux ni pire. Autrement et sans doute définitivement. Ah ! si elles pouvaient savoir que nous existons… Tout simplement ! Quant à moi, je persiste et signe : jouir et nous réjouir, d'homme à homme, indissociable exultation des corps épris et antidote à la mort annoncée. Mais pour l'instant… suite d'instants, que la chute est ascendante ! Et combien l'aube hier fut rassasiante !

« Tu as le corps des jours et des saisons. Tu n'as jamais le même corps. Parfois je pense, à te guetter, que tu ne t'appartiens pas. Ta peau ne prend jamais l'ombre ou la lumière de la même manière. Corps recroquevillé, lové sur lui-même, comme au sortir du ventre d'une mère : chaque sommeil t'enfante et te délivre neuf, à mes regards. Ou bien, corps plaqué au drap, tu es là couché sur le ventre, jambes et bras en V comme si tu tombais du ciel : chaque éveil te livre à moi comme au terme d'une chute. Parfois, quand tu me tiens dans tes bras, quand je t'écrase contre moi, tout se met à tournoyer. Plus aucune pesanteur pour nous retenir. L'espace est tourbillon.
Tu as le corps des jours et des saisons. Tu n'as jamais le même corps. Ta peau a l'odeur de nos balades. Elle prend celle du vent ou bien celle de l'herbe. Elle retient les senteurs de terre meuble, et le parfum des aubépines. L'odeur de ta peau m'égratigne. Acre, je m'y plonge et j'y goûte comme un alcool fort. Il n'y a pas de pli en toi qui ne recèle une netteté exhalante. Chacun de tes pores m'est une bouche et j'y respire tout ce que tu as capté de lumière et de pluies, de soleil et de nuit. Chaque senteur, chaque odeur, chaque parfum m'est une découverte. Tu es toute une nature réunie en un corps, comme un poing.
Tu as le corps des jours et des saisons. Tu n'as jamais le même corps. Et le jour, pour nous, est moment de guet. Je t'observe, habillé, allant, marchant, lisant, travaillant ou t'occupant de telle ou telle tâche pour la maison. Je te traque. Je t'attends. Je t'imagine sous tes vêtements, fixant pour moi toutes sortes de senteurs. Ce que tu respires et fixes le jour, je le hume de nuit. Et parfois, à te voir me sourire, prendre une distance à bout de bras pour souffler un instant, au cœur d'une étreinte, je me dis que tu es heureux de ce que tu me livres là, comme un souffle de toi-même toujours renouvelé. Jamais rien de toi ne m'est familier. Je ne te reconnais pas. Je t'observe, le jour durant, puisqu'il est d'habitude de ne nous retrouver que la nuit, en m'interrogeant sur la nature de ton corps à venir, du corps de la journée. Et le temps passe ainsi de jour en jour. En cela, tu m'étourdis. Sous tes vêtements, tu fais des réserves de vie.
(…) Tu as le corps des jours et des saisons. Tu n'as jamais le même corps. Et là, derrière tes genoux, qu'ai-je découvert ? D'autres plis encore, tout emplis de sel, comme un goût de sang. Parfois, entre mes dents, aussi, un de tes poils, et je le croque. Tout de toi est beau. Comme je voudrais dire tout cela à la mesure vraie des silences qui sont partage, des élans qui sont heurts, des étreintes qui à chaque fois nous font renaître, aiguisant nos désirs. Il n'y a de lassitude que pour ceux qui n'admettent pas qu'ils sont ce qu'ils sont. Il n'y a de saleté que pour ceux qui ne savent pas s'aimer, et aimer, se regarder tels qu'ils sont et regarder l'autre tel qu'il est, toujours différent, au gré du temps. Il n'y a pas que le corps. Mais tout passe par le corps, pages de l'esprit.
Tu as le corps des jours et des saisons ! Je gravite autour de toi. Tu me lâches dans l'espace pour mieux me rattraper. Surtout, ne m'abandonne pas, un jour. Je n'en finirais pas de tomber. Le temps tisse et nous tisse pour nous envelopper. Nous nous usons, limons, rabotons l'un et l'autre. Il ne restera de nous que des corps vieillis. Et un jour quelque chose craquera en toi, ou en moi. Mais pour l'instant, suite d'instants, que la chute est ascendante ! Elle nous grandit quand tout nous fut enseigné pour tapir et enrayer. Tu me regardes ? Je suis déjà dans tes yeux. Tu me tends la main ? Je roule déjà dans la vallée de tes paumes. Tu te déshabilles ? Je regarde ton sexe sombre, sa poche lourde, sa toison en broussaille et je fais déjà la quête buissonnière. Je me perds dans cette forêt vierge. Je salue le totem. Mon chant est celui des bergers d'autrefois, quand les hommes de loi n'avaient pas encore trop travaillé. Quand ils n'avaient pas encore inventé la propriété de toute nature. Quand nous étions encore Nature. Ici, à l'orée de la ville, au lieu de notre sang et de notre naissance, nous vivons ce que notre siècle ne vivra définitivement plus. Peut-être sommes-nous les derniers d'une tribu sauvage ? Où sont les autres que nous ne rencontrerons jamais ? Ah ! s'ils pouvaient savoir que nous existons, nous aussi. Le grand repas de nos corps est salut. Il nous restaure. »
Yves Navare, Le petit galopin de nos corps, R. Laffont, 1977 ; réédité chez H&O.

Le plus beau livre d'amour que je connaisse. Une œuvre grave, frémissante, passionnée. Comme nous deux, ils avaient épousé des femmes – Sabine et Clotilde ; comme nous deux, ils ont eu des enfants qui ont grandi et sont partis. Mais rien ne les a plus séparés, sauf maintenant la mort qui a pris Joseph. C'était prévu depuis toujours – ne pas vieillir indéfiniment ensemble – mais tellement cuisant lorsque survient l'absence ! Alors Roland raconte dans un cahier ce que fut leur vie durant près de trente années. « Ces pages me sont herbes coupantes. Aujourd'hui, 8 juin 1935, pas même un mois après ta mort, Joseph, par le secours de cette encre, et de ce stylo que je saisis comme nous nous sommes brandis, je vois bien que notre vie tient aux mots. Et si, après tout, nous allions vivre deux fois ? Deux portraits de nous. L'un en creux, de notre vécu, de notre combat. L'autre, en pleins et déliés, de ce cahier. Ai-je été sacrilège ? Le second oblitère-t-il le premier ? Ou bien est-il tremplin ? »
Une telle littérature enchantée autant qu'habitée – ô combien tremplin, entrain et refrain ! – recharge bien sûr mon inspiration matinale devant mon clavier qui crépite d'aise ! Oui, oui, car la vie tient aux mots. Est-il encore possible de délirer innocemment et follement sur ce miracle de la rencontre duelle lorsque le cœur et le corps – le sentiment et la peau – même à distance s'affolent ensemble et célèbrent spasmodiquement leur ineffable et impensable combinatoire pour ne pas parler d'union ni de génitoires ! Souvent, après l'acte d'amour (?!) lorsque… [Je mets ces deux signes de ponctuation et habille d'italiques le mot piégé pour lui complaire s'il lit mon interminable épître]… lorsque, dis-je, apaisé et hébété de bien-être, je scrute la pénombre - car je ne parlerai pas ici de l'hymne paulinienne mais bel et bien de la communion physique indissociablement génitale et sentimentale, bref, c'est alors que je ressens cette urgence exaltée de convoquer les mots, les plus violents, les plus doux, forcément inusités, à la limite indicibles vocables qui ne seraient d'aucune langue, d'aucun usage, hors verbiage, hors commérage, totalement intraduisibles, donc j'éprouve ce besoin d'inventorier ces mots-pépites pour sur-le-champ les ordonner dans une hâte lyrique autant que spasmodique. Un peu comme lorsque j'étais enfant : à peine arrivé à l'orée de l'immense champ où des milliers de marguerites ployaient sous la brise, je courais à perdre haleine, je me noyais dans les tiges, je fauchais plus que je ne cueillais. Puis, dans mes bras trop petits, je tendais à mes parents ma récolte luxuriante, tellement comblé, aussitôt dépité : j'aurais voulu leur offrir la prairie entière ! Ma mère me grondait gentiment devant un tel gâchis. Moi, je me sentais à la fois ravi et bizarrement démuni. Un peu dépité aussi car mes froids géniteurs ne communiaient pas à mon exubérance.
Lui aussi, quand parfois il m'arrive de le réveiller pour lui confier mon impossible projet, cette gerbe de mots que je ne parviens pas à nouer dans le noir, il se moque en maugréant : que vas-tu chercher là ! Pourquoi des commentaires ? « C'est » un point c'est tout. Et il n'a pas tort, je dois bien l'admettre : en certains domaines, les mots sont infirmes. Il en va de la rencontre amoureuse comme pour la musique : quand on a dit que l'une est vibration d'air sonore, que l'autre est l'aimantation de deux épidermes, on a tout dit et on n'a rien dit. Il n'empêche, j'ai besoin, moi, comme ici ce matin, des impossibles mots, de les agencer encore et encore comme un puzzle jamais achevé, de les tresser pour une couronne jamais fanée, de les composer en aubade inspirée, peut-être simplement parce que je crains d'oublier un tel prodige, je redoute qu'il ne se reproduise plus (elle veille, la Faucheuse embusquée !), je me désespère par avance que l'aube, loin d'être une promesse comme aujourd'hui, ne soit le plus souvent pour tous deux que prose et tristesse...
Mais qu'importe puisqu'il est là, puisque - arc-boutés ou allongés, côte à côte ou superposés - nous sommes ensemble en cette fraction de folie émerveillée ! Puisque dans deux mois, nous nous étreindrons à nouveau après de trop longues semaines d'absence et d'abstinence. Cette fois, ce n'est plus comme au pensionnat lorsque tous les mômes, moi compris, nous faisions des croix dans notre agenda secret - autant de jours qui nous séparaient de la quille, comme nous l'appelions. Aujourd'hui, adulte raisonnable bien qu'éternel homme-enfant, je ne décompte plus. C'est juste une furtive résurrection – comme en ce matin de juin – plus souvent une impression légère... une tranquille euphorie qui flotte dans l'air... certitude paisible née de tant de voluptés déjà engrangées et liées par cette tendre et virile évidence : lui, moi, nous deux ensemble. Avec, palpitant dans le cœur et électrisant dans le sexe, ce credo minimaliste : ce sera toujours aussi fantastique, ce n'est jamais pareil ! Et, sauf la mort, ce n'est pas près de cesser puisque ni le temps ni la distance n'ont rien pu faire pour dissoudre ou détricoter la connivence.
Bien sûr, ce n'est pas une preuve ni une garantie encore moins un contrat, juste une évidence. Et une confiance que je sais partagée. Disons une complicité. Donc nul stress, nulle impatience. Veillée d'âme plus que veillée d'armes. Pas même le désir, quoique (quel faux-cul je fais ! mais l'érotisme solitaire a ses limites…). C'est aussi notre vieille sagesse qui, à force, fait son effet : l'attente est le raffinement du plaisir ! Attente lucide : il s'agit de paire, je le redis, plus que de couple. Il s'agit de bien-être, oui, je radote, pas de bonheur. Simplement le bien-être lorsqu'il est à la fois profond et léger, mental et corporel, occasionnel et éternel, en tout cas jamais fusionnel. Même si la fusion - ou l'hymen en grande pompe ! - reste mon délire d'un instant, un toc inoffensif dont je ne compte pas guérir tant il me divertit et m'attendrit ! Seule importe l'Alliance (majuscule ! pas l'anneau). Avec ou sans folklore. Avec ou sans mot – de préférence sans discours. Et surtout pas de preuve ni de promesse.
Tu as le corps des jours et des saisons ! chante Navare. Nous gravitons l'un autour de l'autre. Nous recréons assidûment ce corps unique noué depuis plus de dix ans au fil des heures et des saisons. Pour nous prendre dans l'intervalle avec ferveur et ensuite nous déprendre. C'est ce lien charnel et éphémère qui faufile la durée et ressoude l'absence. C'est cette incommensurable volupté qui donne la mesure du plaisir de vivre et d'échanger au tréfonds. Ainsi, comme on dit, je t'ai dans la peau. Et toi réciproquement, même si plus que moi tu te défies des mots et brandis le prétendu handicap affectif censé te protéger ! Tu n'y crois plus guère et c'est tant mieux ; même si nous avons toujours besoins de parades sinon d'armures. Mais qu'importe puisque nous nous convenons ainsi et nous nous assemblons quand le temps est arrivé. Sans honte ni fausse pudeur. Pas de zone interdite, pas de chasse gardée, pas de noblesse ici ni de honte plus bas. Des caresses inédites, que chacun connaît par cœur et apprécie, des impros aussi, des élans furieux et des gamineries ou d'invraisemblables obscénités. Rire et jouir ! Jouir et nous réjouir ! Ni corvée conjugale ni devoir sodomite, seule la rencontre au sommet, le bel et bon jouir, la fête, le double concerto, la Symphonie des jouets, la Pathétique, l'Hymne à la joie, la grande Toccata, la symphonie Résurrection mais aussi Petrouchka et Pierre et le Loup, toutes ces « babouineries » (tel est notre vocable) dans la plus pure innocence, la déviance dans toute son outrance, sa poésie, sa compulsion, son humour toujours... oui, te retrouver au cœur de l'été, te caresser bientôt, grimper au septième ciel, t'effleurer, te pétrir, t'envelopper, te frôler, te pressurer, te meurtrir, t'aspirer, te mordre, t'assiéger, t'investir, te dévorer tout vif, butiner dans on cou, sur ton front si halé, dans le creux des oreilles, sur ton sceptre brandi, sur le rubis écarquillé, partout, à perdre haleine, me perdre dans ta gorge, dans le val d'une épaule, m'essouffler, haleter sur tes lèvres (ça, tu détestes !), mélanger nos sueurs, me lover dans tes replis, folâtrer dans ta trop maigre toison, explorer le ténébreux vallon, remonter jusqu'à l'épaule ronde, si bellement bronzée, y surfer jusqu'au téton droit (celui que je préfère)... puis délaisser enfin ces amuse-gueules, nous enfoncer dans la spirale sans retour, bramer comme deux malades et, soupir ou sanglot – à chacun sa chanson ! – s'offrir l'un à l'autre nos spasmes opalescents...
Le repas de nos corps. Ça tombe bien puisque voilà deux gars qui adorent l'œnologie et la gastronomie, l'un depuis toujours, l'autre parce que qu'il est un disciple docile et émerveillé ! Un repas qui chaque fois s'instaure et nous restaure. Exultation des peaux amoureuses et antidote de la mort annoncée. Effusion, fusion, dérision... Quand je me repasse le film de nos étreintes si tendres, si violentes... si apaisantes et si désespérantes...si folles et si drôles, parfois franchement incongrues (" babouineries ", bis repetita placent, puisque tel est le mot définitif qu'auraient dénigré Roméo et Juliette mais que nous, nous avons adopté pour ce genre de gymnastique euphorisante qui vaut bien un Margaux sans promettre la lune ! ), bref, à l'issue de nos facéties de gibbons, je me retrouve toujours face à ce constat : ce n'était donc que ça ??? C'est tout ça !!! « C'est ». Et - après avoir savouré - il vaut mieux en rire aux larmes qu'en pleurer amèrement. Car, comme le synthétise excellemment Onfray (Théorie du corps amoureux, Grasset, 2000), « ...naître, vivre, jouir, souffrir, vieillir et mourir révèlent l'incapacité à endosser une autre histoire que la sienne propre et l'impossibilité viscérale, matérielle, physiologique, de ressentir directement l'émotion de l'autre. Avec lui, près de lui, à ses côtés, au plus proche, certes tendresse autant qu'empathie restent possibles, mais pas à la place de l'autre, avec sa conscience, dans sa propre chair. Jouir de la jouissance de l'autre ne sera jamais jouir la jouissance de l'autre. Pareillement pour ses souffrances et les autres expériences existentielles. On désire la fusion, on réalise l'abîme. ».
Vertigineux abîme. Mais alors, en arrière toute ? Cruelle démystification ou invite nouvelle ? Mais non, c'est très bien ainsi ! Bref et intense. Périssable et inoubliable. En tout cas loin des bêlements sentimentaux, des prétentions fusionnelles, des consolations catholiques... ou de l'infirmité (ou fatuité) du langage poétique. Oui, la meilleure conclusion du bel et bon jouir : une formidable hilarité et une lucidité coup après coup plus aiguisée. Certes, comme disait aussi Mireille Havet, la Vierge des années folles avec qui j'ai flirté dans Cet été plein de fleurs et qui savourait, elle, d'autres extases autrement vénéneuses : « Les plaisirs de la chair sont de cendres ; elle a l'éclat du phénix, mais d'elle, on ne renaît pas. » Renaître ! Qui parle de renaître ? Simplement survivre. Car, chère miss, au-delà de la petite mort, rien de tel pour déguster le reste de ta vie que la fulgurance et la volupté de l'Instant-Éternité ! L'orgasme, surtout quand il dégorge de l'affection, est un cadeau des Dieux : ce délicieux orage épileptique engloutit frénétiquement le Temps et son imposture est aussi banale qu'indispensable.
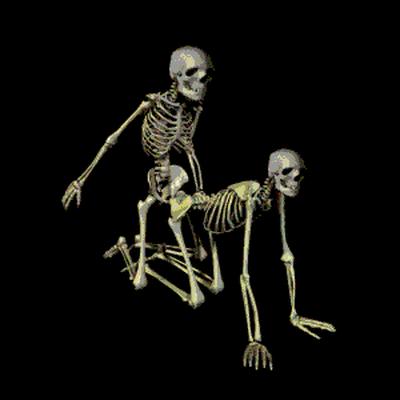
POST SCRIPTUM. Au pique-nique de midi, dans la froidure de Garches où j'ai dû brancher le radiateur un 20 juin, alors que m'épiait derrière la vitre notre impudent rouge-gorge, afin que mes papilles participent elles-aussi à la fulgurante réanimation opérée au réveil par les mains et les épaules auto-enlacées, en fermant les yeux j'ai minutieusement savouré un énorme macaron. Parfumé au café, bien entendu. Et forcément proustien !